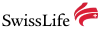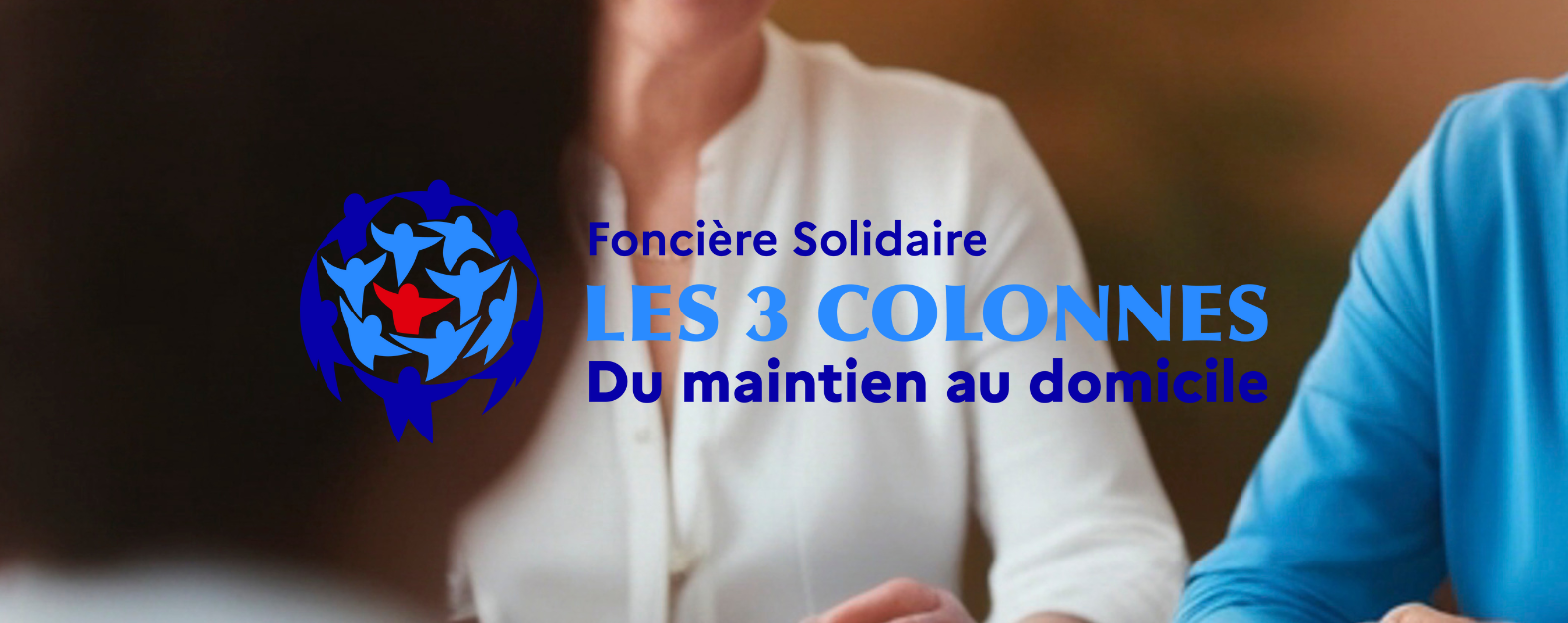Trouver des lingots d’or chez soi : une aubaine… très relative
PATRIMOINE | 4 min. de lecture
Sommaire
Ce que dit réellement le Code civil sur les trésorsPourquoi la majorité des découvertes ne sont pas des trésors au sens juridiqueQuelle est la procédure officielle après une découverte ?Le traitement fiscal d’un trésor ou d’un bien trouvéLes trésors domestiques : entre fantasme populaire et réalité juridiqueEn bref : une découverte exceptionnelle, mais rarement une source d’enrichissementBeaucoup rêvent de tomber un jour sur un trésor enfoui dans leur maison : des lingots d’or oubliés dans un mur, un sachet de pièces anciennes dans le jardin, une cache dissimulée sous un plancher. Pourtant, en droit français, trouver de l’or chez soi n’offre presque jamais la possibilité d’en profiter librement. Le Code civil encadre strictement ces situations et protège avant tout les propriétaires légitimes ou leurs héritiers, même s’ils sont très éloignés.
Cet article explique en détail ce que dit réellement la loi, ce qui est qualifié ou non de « trésor », comment se déroule la procédure après une découverte, et pourquoi le découvreur n’est généralement pas enrichi.
Ce que dit réellement le Code civil sur les trésors
La notion de « trésor » est définie par l’article 716 du Code civil, et son champ d’application est beaucoup plus étroit qu’on ne le croit. Selon la loi, un trésor est :
-
un bien caché ou enfoui,
-
ancien,
-
découvert par pur hasard,
-
et dont personne ne peut revendiquer la propriété.
Ces quatre conditions doivent être réunies simultanément. Dès qu’un seul critère fait défaut, la découverte ne relève plus d’un trésor, mais d’un autre régime juridique bien moins favorable au découvreur.
Lorsque la découverte entre réellement dans le cadre du trésor, la répartition est la suivante :
-
100 % pour le propriétaire du terrain, lorsque la découverte est faite chez lui.
-
50 / 50 lorsqu’une personne extérieure découvre le trésor sur le terrain d’autrui (par exemple un locataire, un artisan ou un ouvrier).
Mais la plupart des découvertes domestiques échappent rapidement à cette qualification, pour une raison simple : il suffit qu’une personne identifiable puisse revendiquer la cache pour que la découverte cesse totalement d’être un trésor. Cela peut être :
-
un ancien propriétaire,
-
un héritier,
-
un vendeur,
-
un membre de la famille,
-
ou toute personne associée au bien immobilier.
Dans ce cas, le découvreur n’a aucun droit, même s’il est celui qui a mis l’objet au jour de manière fortuite.
Accessible à partir de
Versement trimestriel
Frais d'entrée / Sortie
Frais d'arbitrage
Jusqu'à
net annuel
Pourquoi la majorité des découvertes ne sont pas des trésors au sens juridique
En pratique, le régime du « trésor » est très rarement applicable. Plusieurs arguments juridiques entrent systématiquement en jeu.
D’abord, le bien retrouvé a souvent été caché par un ancien occupant, ce qui implique immédiatement l’existence d’un propriétaire identifiable. Dès lors qu’une personne peut démontrer un lien familial, patrimonial ou successoral avec la cache, même indirect, la propriété initiale prime.
Ensuite, une maison ou un terrain possède toujours un historique de vente ou de succession. Actes notariés, titres de propriété, transmissions familiales : ces éléments suffisent parfois à reconstituer l’origine du bien et à déterminer un héritier ou un ayant droit, même plusieurs décennies après les faits.
Enfin, beaucoup de caches domestiques contiennent des objets relativement récents – pièces d’investissement, lingots, bijoux – qui ne peuvent, par définition, être qualifiés d’objets « anciens ». Cela suffit également à exclure la qualification de trésor.
Dans toutes ces hypothèses, la loi est claire : la découverte ne confère aucun droit au découvreur, même lorsqu’il est propriétaire du terrain. Le contenu doit être transmis à son propriétaire légitime, ou à défaut, à l’État.
Quelle est la procédure officielle après une découverte ?
Lorsqu’une personne découvre un objet de valeur enfoui ou caché, elle doit impérativement respecter la procédure prévue par la loi. La tentation de garder le silence est compréhensible, mais elle constitue une infraction.
La première étape consiste à déclarer immédiatement la découverte à la mairie ou au commissariat. Un inventaire officiel est ensuite établi pour décrire et authentifier les objets.
Le dossier est transmis au Service des Domaines (DGFiP), qui dispose d’un rôle central :
-
identification des héritiers potentiels,
-
analyse de l’historique du bien immobilier,
-
recherche d’indices permettant de retracer la propriété du bien,
-
consultation d’archives ou d’actes notariés.
Le procureur peut par ailleurs ordonner des enquêtes complémentaires, comme une enquête de voisinage ou une vérification de successions anciennes.
Si aucun propriétaire ni héritier ne peut être identifié malgré toutes les recherches, la loi prévoit que l’État devient le propriétaire du bien, au titre des biens vacants. Le découvreur n’a pas de droit prioritaire sur la trouvaille.
Accessible à partir de
Frais de sortie
Frais d'entrée
Jusqu'à
net annuel
Le traitement fiscal d’un trésor ou d’un bien trouvé
La fiscalité dépend étroitement de la qualification juridique de la découverte.
Lorsque l’objet est véritablement un trésor, ce qui est très rare, la cession éventuelle peut être soumise au régime des plus-values sur métaux précieux. Toutefois, ce régime suppose normalement la capacité de prouver une date d’acquisition, ce qui est paradoxal pour un trésor ancien.
Dans la quasi-totalité des cas, la découverte ne relève pas du trésor, mais du bien trouvé. Dans ce scénario, la fiscalité est extrêmement simple : le découvreur ne bénéficie d’aucun avantage, car il n’est pas propriétaire. Toute imposition éventuelle concerne exclusivement le propriétaire légitime ou ses héritiers.
Ainsi, même si la valeur de la découverte est très importante, le découvreur ne retire généralement aucun gain financier, ni immédiat, ni fiscal.
Les trésors domestiques : entre fantasme populaire et réalité juridique
Les récits de trésors découverts par hasard nourrissent l’imaginaire collectif depuis des siècles. Pourtant, la plupart des « trésors » découverts dans les habitations ne sont en réalité que des biens dissimulés par un ancien occupant, un ascendant ou un propriétaire précédent.
La loi française favorise systématiquement :
-
la protection du droit de propriété,
-
la transmission patrimoniale,
-
la priorité donnée aux héritiers.
Dans presque tous les cas, le découvreur ne peut pas revendiquer la propriété du bien, même s’il l’a trouvé sur son propre terrain, par hasard, et sans intention spéculative.
En bref : une découverte exceptionnelle, mais rarement une source d’enrichissement
Trouver des lingots d’or ou un ensemble de pièces anciennes chez soi peut sembler extraordinaire. Pourtant, le cadre juridique français transforme très souvent cette découverte en simple anecdote, dépourvue de conséquences financières pour le découvreur.
La notion de trésor est extrêmement restrictive, et les règles relatives aux biens trouvés ou aux successions prennent rapidement le relais. Dans les faits, le propriétaire initial ou ses héritiers sont presque toujours privilégiés, et le découvreur ne reçoit au mieux qu’un remerciement symbolique.
La morale est simple : les trésors enfouis font rêver, mais le droit français les protège rarement au profit de celui qui les découvre.
Faisons le point sur votre
Aucun investissement n’est garanti sans risques. Chaque investissement comporte des risques spécifiques (fluctuations des marchés financiers, risque de change, risque de liquidité, risque de perte en capital partielle ou totale, risques liés au marché immobilier – liste non exhaustive).
Chaque investissement a une durée de détention recommandée ; l’attention de l’investisseur est attirée sur le fait de bien vérifier l’adéquation de cette durée avec ses objectifs et sa situation.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est susceptible d'être modifié ultérieurement. Les avantages fiscaux ne doivent pas constituer la seule motivation d’un investissement.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Vous souhaitez aller plus loin ? Contactez-nous :